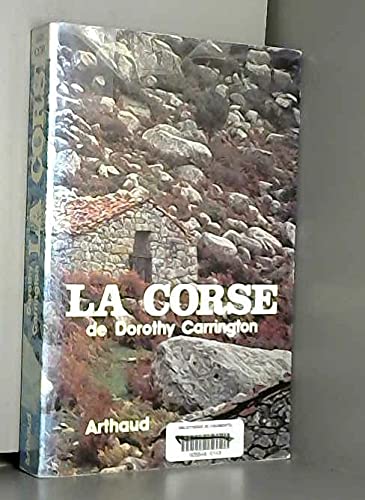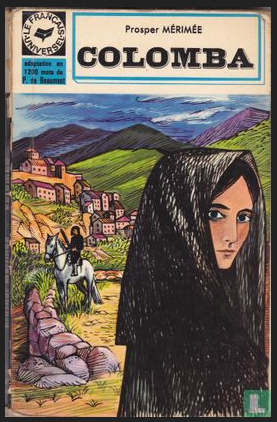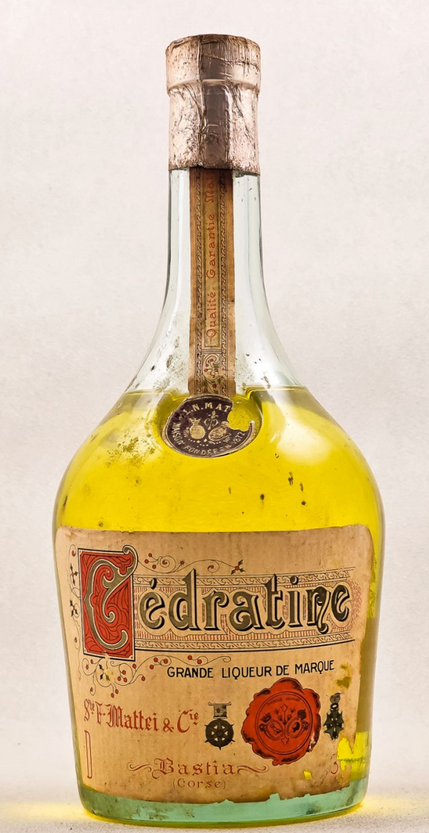Le riacquistu s’inscrit dans un mouvement qui va au-delà de la Corse. Dans les années 1970, le combat pour la culture, l’apparition d’une conscience écologique sont autant de thèmes qu’on peut retrouver partout. Mais dans l’île, après des décennies pendant lesquelles, l’histoire, la culture et bien sûr la langue ont été ignorées pour ne pas dire méprisées, le riacquistu a pris une dimension essentielle et même vitale.
Une approche globale est faite dans cet article de Cairn sous la plume d’Anne Meistersheim
Le riacquistu est littéraire (la revue Rigiru par exemple) ou s’intéresse à l’architecture traditionnelle comme vecteur de construction de l’âme populaire. Ce qui m’intéresse c’est de voir d’où nous sommes partis et comment les choses ont évolué au travers d’un sujet bien particulier..la chanson.
Les moins jeunes se souviendront sans peine de ce que dans les années 60 et encore plus tard, on appelait la chanson corse. Une époque où dans les soirées corses, on se levait quand retentissait l’Ajaccienne..
Qu’il soit fêté dans sa maison
L’enfant prodigue de la gloire
Napoléon, Napoléon
L’enfant prodigue de la gloire
Napoléon, Napoléon
Ce n’est pas tant la qualité de ces chansons, ni même le talent de certains interprètes qui est en cause. Non. Le problème des textes et de la musique se situe ailleurs. Parfois, en langue corse mais ce qui restait chez les auditeurs, c’était les chansons de Tino Rossi, quelques ritournelles de guitare et pas grand-chose de traditionnel. Du folklore. Et parfois dérangeant car il relevait d’une caricature conforme à ceux que les autres pouvaient penser de nous.
J’ai en tête une chanson. Elle est de Charles Rocchi. Voix superbe, il chantait en corse des textes parlant du village et de temps en temps, une ritournelle en français comme la boudeuse ou le quartier maître. Sans doute pour lui du second degré. Mais pour les touristes qui l’entendaient, à mon avis, c’était conforme à l’image qu’il se faisaient des insulaires.
J’ai quitté ma belle tonkinoise
C’est pour toi ma charmante corsoise
Toi qui as des choses si belles à me dire
Toi qui mange encore du figatelli…
…………………………………………………………….
Allons ne rougis pas et n’aie pas honte
Si tu ne descends pas alors je monte
J’en ai assez de tout ce riz bouilli
Ça vaut pas la pulenta du pays
Et oui le Tonkin, la femme corse timide, le figatellu et la pulenta. Tout y est.
Tout y est sauf l’essentiel. La langue, l’histoire et la forme traditionnelle du chant. La polyphonie ! Paghjelle ! Mon premier article de blog, celui qui m’a donné envie d’écrire sur la Corse, mon riacquistu à moi, était consacré à Jules Bernardini qui a fait renaître ces formes d’expression mourantes.
Canta u populu Corsu, i Muvrini et tant d’autres parlent de la Corse avec parfois des orientations qu’on peut ne pas partager. Mais que ce soit en polyphonie ou sous forme de chanson plus classique, ils mettent en valeur des choses authentiques. A tribbiera.. le mouvement des bœufs dans l’aire de battage du blé.. u lamentu di u pastore bien loin de la vision virgilienne du berger..i mulateri d’Ulmetu..hommage aux animaux et aux hommes, Mal Cunciliu et la figure du mazzeru et bien entendu, ma préférée, a muntagnera.
Et tant d’autres. Chacun fera son choix. Moi par exemple, je ne supporterai pas une soirée entière de paghjelle parce que ce serait identitaire.
Entendons-nous bien. Il ne s’agit pas de renier ce qu’était la chanson corse avant le riacquistu. Elle a fait partie de l’histoire. Antoine Ciosi, Charles Rocchi ou encore Regina et Bruno ont chanté en langue corse. Ce n’est pas leur faute si l’époque voulait des choses qui correspondait à une idée reçue de la Corse.
Réappropriation de la langue au travers de la culture, de l’art, des savoir-faire, c’est parfait !
Le tout c’est que ça n’exclut personne.
PS.. le blog que vous parcourez, fait partie d’un site dédié à l’apprentissage de la langue corse. Si vous voulez le découvrir, cliquez sur l’image ci-dessous…